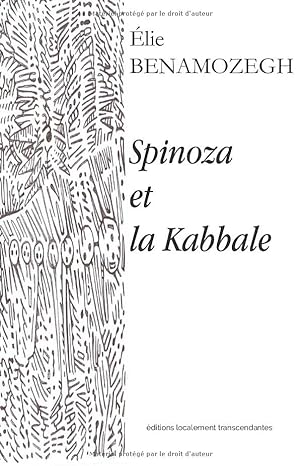Spinoza et la Kabbale
Élie Benamozegh
Dans cet essai de 1863 depuis longtemps indisponible, Élie Benamozegh, le rabbin kabbaliste de Livourne, révélait au public francophone le secret des véritables sources métaphysiques de Spinoza : la Kabbale.
La chose ne fut jamais ignorée des hébraïsants. Salomon Maïmon, cet autre évadé de la Synagogue, notait déjà dans son autobiographie : « Je lisais Spinoza. Sa pensée profonde et son amour de la vérité me plaisaient excessivement, et dans la mesure où son système m'avait déjà été suggéré par les écrits cabbalistiques, je recommençais de le méditer, et devins si convaincu de sa vérité, que tous les efforts de Mendelssohn pour me faire changer d'opinion furent vains. » Il va même jusqu'à affirmer que « la Cabbale n'est rien d'autre qu'un spinozisme généralisé ».
La démonstration par Élie Benamozegh des sources de Spinoza s'appuie sur l'analyse de déclarations explicites de ce dernier. Ces indications sont pourtant généralement ignorées ou incomprises des historiens de la philosophie, car leur intelligence nécessite la connaissance de la culture indigène de Spinoza, le judaïsme rabbinique.
Mais le rabbin de Livourne ne s'arrête pas à cette contribution historique. Il pénètre dans la conceptualité des deux systèmes, la kabbale et le spinozisme, pour expliquer et approfondir l'un par l'autre. Il soulève une difficulté majeure au cœur du spinozisme, celui de la place de l'Idée de Dieu.
Cette longue disquisition comme il l'appelle, technique et serrée, fera comprendre le malentendu qu'il y a à vouloir verser Spinoza à l'histoire du matérialisme, ou à l'adopter comme consolateur du désastre du marxisme.