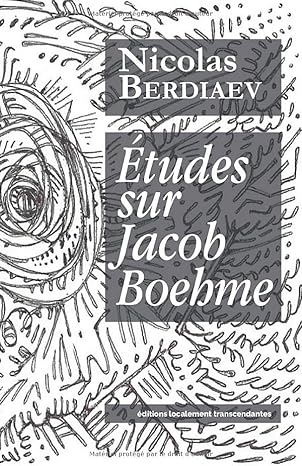Études sur Jacob Boehme
Nicolas Berdiaev
Traduit du russe par Samuel Jankélévitch
Jacob Boehme est un auteur notoirement rébarbatif. Il s'exprime dans les registres du mythe et de la révélation personnelle. Il forge ses métaphores et ses analogies avec le vocabulaire de l'alchimie, qui nous est devenue incompréhensible. Il puise ses références à la source des Écritures, que nous ne connaissons plus. Il plonge au cœur de l'abîme sans fond pour contempler l'engendrement de Dieu du sein de la Divinité, dans le courroux et la colère. Cette obscurité et cette étrangeté ne doivent pourtant pas nous décourager de découvrir un auteur décisif dans le développement de la philosophie occidentale.
C'est en effet à l'intuition fondamentale de Jacob Boehme, celle de l'Ungrund, que s'est abreuvé l'idéalisme allemand. Sans le cordonnier théosophe de Görlitz, jamais les Fichte, Hegel et Schelling n'auraient pu se libérer des geôles mentales bâties par les Hellènes. Cette pensée paradoxale, chantée plus qu'argumentée, leur a permis de s'arracher à la clarté illusoire de la métaphysique classique.
Cette exploitation des visions de Jacob Boehme par l'idéalisme allemand, Schelling surtout, a introduit la volonté et l'Histoire au cœur de la métaphysique. On sait le rôle décisif de cette inoculation dans les développements de la modernité, de son hubris, de ses égarements, de ses désastres. Mais cette exploitation, sous couvert de dépassement conceptuel et scientifique, n'a-t-elle pas manqué la singularité de Jacob Boehme ? N'a-t-elle pas tenté de résorber une irruption, singulière et irréductible, qui recèle peut-être encore des possibilités inouïes ?
Nicolas Berdiaev, parce qu'il maîtrisait la philosophie d'un point de vue extra-philosophique, celui d'une foi ardente et indomptable, a su saisir et faire comprendre cette singularité. Dans ces Études parues en 1945, Berdiaev nous introduit au cœur de cette Vision en termes clairs, mais du point de vue du Voyant et en empathie spirituelle avec lui. Il nous introduit à l'urgence de méditer Jacob Boehme.